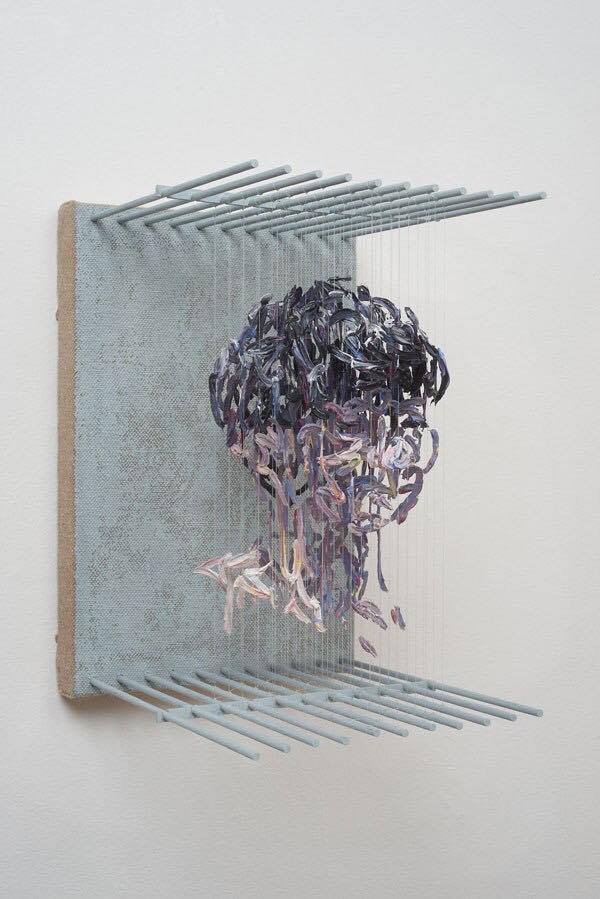Francis Alÿs, la politique par l’absurde.
« Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu’au sommet d’une montagne d’où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé avec quelque raison qu’il n’est de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. »[1]
Face aux œuvres de Francis Alÿs, nous ne pouvons nous empêcher de penser à ces lignes de Camus. Né en 1959, cet architecte belge part s’installer à Mexico à la fin des années 1980. Il adopte alors une pratique artistique variée avec une prédilection pour la performance. On l’y voit déambuler, tirer, porter, grimper, creuser, s’activer, s’épuiser, s’acharner, sans finalité apparente. Son mot d’ordre : « effort maximum pour un résultat minimum ». Dans Paradox of Praxis 1 (1997), l’artiste pousse un imposant cube de glace dans les rues de Mexico. Rapetissant au fur et à mesure de son avancé, le bloc finit par disparaitre, ne laissant pas même derrière lui la trace humide de son passage, mangée par le soleil. Cette action illustre l’aphorisme “Sometimes doing something leads to nothing” (“Parfois, faire quelque chose ne mène à rien”), sous-titre de l’œuvre. Dans une même veine absurde, une coccinelle Volkswagen s’obstine à gravir une colline de Tijuana dans Rehearsal I (1999-2001), sous les encouragements d’un groupe de Mariachi en répétition. A chaque pose des musiciens, elle dégringole la pente si péniblement escaladée. Elle reprend alors son élan en vue d’atteindre le sommet. L’opération se répète inlassablement, nous créant un sentiment empathique de frustration envers la voiture. L’effort improductif est au cœur de l’œuvre de Francis Alÿs. Il s’oppose ainsi à un discours capitaliste prônant l’efficacité constante. Qui ne s’est jamais entendu dire « Tu perds ton temps à faire ces choses », sous-entendant ainsi « tu dois avoir un usage productif de ton temps ». Le temps humain et de la sphère privée s’adaptent, se calent sur le temps de l’économie et du travail. Il est rationalisé et fait face à des impératifs d’accélération. Il s’attache ainsi à ce que les personnes qui participent à ses actions soient des volontaires non rémunérés, gaspillant délibérément leur énergie. L’errance, présente dans l’essentiel de ses œuvres, prend dans ce contexte une place toute particulière dans le travail de l’artiste : « Marcher, en particulier errer ou flâner, c’est déjà – en rapport à la culture de la vitesse de notre époque – une sorte de résistance. »
Car c’est comme un résistant que se présente Francis Alÿs, s’interrogeant sur les impacts politiques significatifs que peut avoir l’art aujourd’hui : « Une intervention artistique peut-elle réellement provoquer une façon de voir imprévue, ou s’agit-il plutôt de créer une sensation « d’insignifiance » qui démontre l’absurdité d’une situation ? »[2]. Lorsqu’il arrive au Mexique, il constate qu’il reste un témoin extérieur face aux crises économiques, sociales et politiques que traversent le pays. Dans Turista (1994), il questionne la légitimité des artiste étrangers à dénoncer la situation locale sans avoir un regard biaisé. Il se joint à un groupe de travailleurs, posté sur le trottoir, indiquant par un panneau placé devant eux leurs qualifications et attendant qu’on leur offre du travail. Entre des plombiers et des électriciens, Francis Alÿs propose ses services de « Touriste », son expertise d’observateur professionnel. La même année, il créé une maison à partir d’affiches électorales fixées ensemble avec Housing for all. Il dénonce ainsi l’hypocrisie des discours politiques de la campagne présidentielle, assurant de faire du logement une priorité. La reprise d’un slogan martelé par les candidats pour le titre de son œuvre accentue l’ironie d’une situation non résolue. Ses actions sont une manière de pointer du doigt des tensions sociales et politiques. Leur intrigue se veut simple de manière à faciliter leur transmission orale. Elles peuvent alors se propager à l’image d’une rumeur qui court, revêtant le caractère de légende urbaine. Francis Alÿs considère que notre société contemporaine a besoin de mythes afin de stimuler l’imaginaire collectif. Bien qu’aboutissant souvent sur un échec, ses travaux apparaissent comme porteurs d’espoir. When Faith moves Mountains (2002) réunit des centaines de volontaires dans un effort commun qui, pelle à la main, déplacent de 10 cm une dune de sable longue de 500 mètres. Il met ici en exergue l’importance des mouvements citoyens dans une société en crise, alternative face à l’immobilisme des gouvernements.
Parmi les causes chères à l’artiste, la question de l’immigration et de la porosité des frontières à l’heure de la mondialisation est récurrente. « Comment peut-on simultanément promouvoir l’économie globale et limiter le déplacement des personnes au niveau mondial ? ». En 1997 avec The Loop, il entreprend un voyage de trente-cinq jours pour se rendre aux États-Unis sans avoir à passer par la frontière entre Tijuana et San Diego. Il évoque alors le caractère infranchissable de ce passage obligé entre le Mexique et les États-Unis. Dans The Green Line (2004), il s’attaque au conflit Israélo-palestinien. Muni d’un pot de peinture verte percé, il marche pendant deux jours dans Jérusalem, retraçant la ligne verte fixée en 1948 entre les deux pays. Il demande ensuite à différentes personnes de commenter son action. Exposé ainsi, ce travail tente d’introduire un débat parmi les spectateurs, les obligeant à sortir de leur passivité.
Tout comme Sisyphe, Francis Alÿs a conscience de l’absurdité de ses actions. Leur dimension à modifier le paysage politique semble vaine. Cependant, comme le concluait Camus, « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme »[3].
Pauline Schweitzer
[1] Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Gallimard, 1942.
[2] Francis Alÿs, 2007.
[3] Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Gallimard, 1942.
- Francis Alÿs, Housing for All, 1994
- Francis Alÿs, Paradox of Praxis I, 1997
- Francis Alÿs, Rehearsal I, 1999-2001
- Francis Alÿs, The Green Line, 2004
- Francis Alÿs, Turista, 1994
Image à la Une : Francis Alÿs, When Faith moves Mountain, 2002, Lima, Pérou, capture vidéo ©Francis Alÿs
Toutes les vidéos de Francis Alÿs sont en libre accès sur son site : http://francisalys.com/