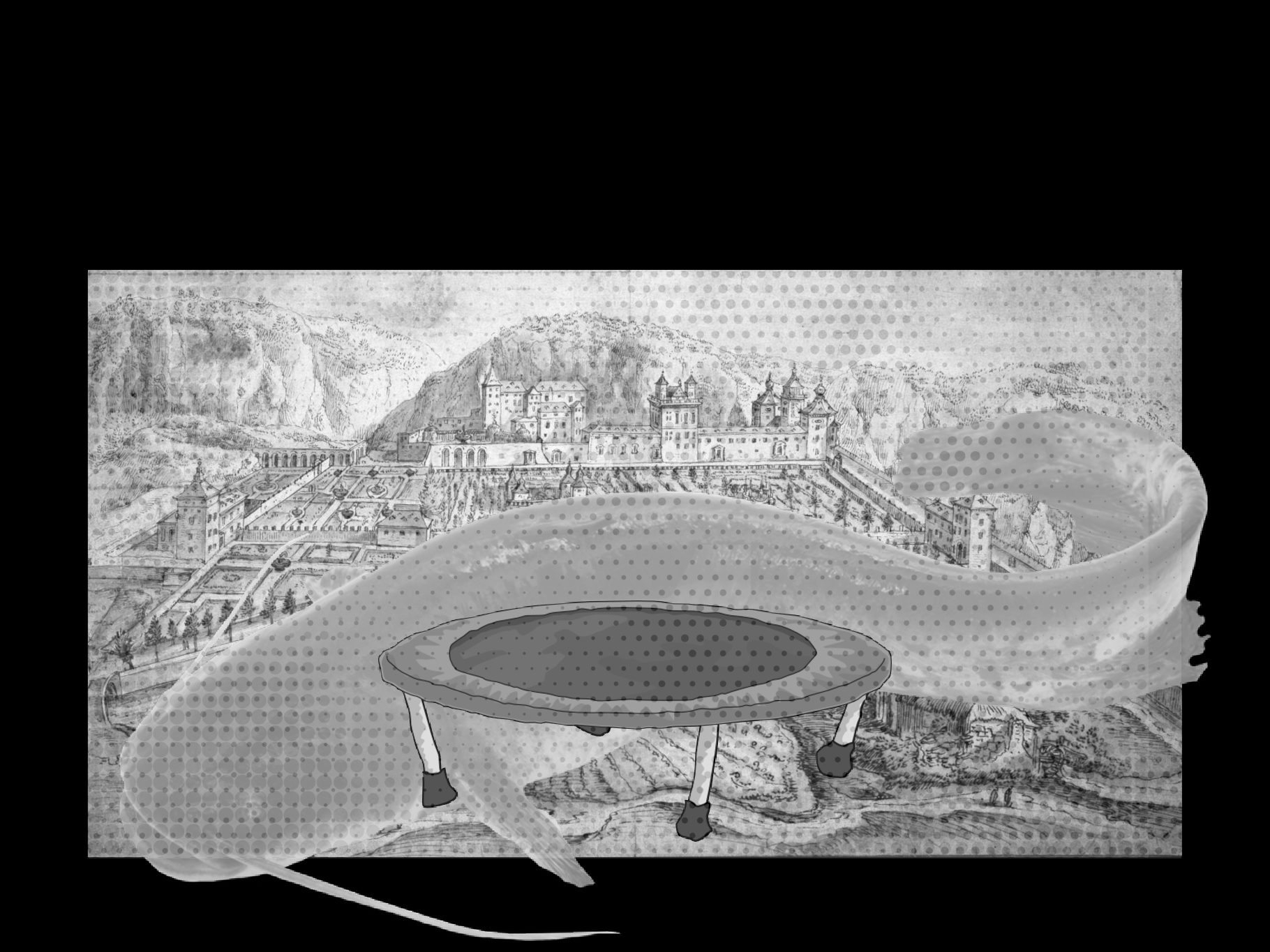Sutures pour raccords
PROLOGUE
J’avais suivi C* le long du canal, talonnant non sans mal le phare accroché à son garde-boue arrière, au bord de l’eau dormante de l’Ourcq, je ne l’avais pas laissé me semer dans le réseau compliqué des petites rues secondaires, gauche-droite-droite-gauche, qu’elle scandait dans sa course au creux de maisons individuelles modestes, de garages et autres zones de stockage, moi essayant de ne pas me tenir droit, d’anticiper les brusques revirements qu’elle appliquait à chaque intersection, calquant mon rythme sur le sien. Nous étions enfin dans une petite rue, face à une porte anonyme de tôle. Elle m’avait fait signe de me taire, et je l’avais suivie dans ce jardin en sommeil, cerclé des fenêtres éteintes des rez-de-jardin, me faisant signe de poser mon vélo sur le sien et de lui emboîter le pas au fond de la cour, derrière une nouvelle porte s’ouvrant sur un espace aux grands volumes, charpente d’acier et de verre qu’elle fit apparaître de manière aléatoire, à la faveur de la lampe torche de son portable, de sorte que l’endroit se donnait à moi de manière lacunaire et fragmentée. Nous étions légèrement ivres, moi sans doute plus schlass que C* qui se faisait mon guide, orientant ma dérive en chuchotant pour me mener dans les alcôves et cellules de l’atelier partagé, stoppant un temps là sur un ensemble de céramiques, là sur des photographies imprimées sur différents supports, au milieu d’un tas de châssis, là sur des peintures encore humides, soulevant les morceaux de bâche qui servaient ici de cloison, pour me faire pénétrer dans un atelier ou un autre, et je m’imaginais au cours de cette visite chuchotée et nocturne, les sons et les odeurs que devaient prendre le Houloc le jour, au gré des présences, idées et pratiques de la petite vingtaine de plasticiens rassemblés ici, la teneur de leurs conversations, celle de leurs déjeuners, l’heure du café, leurs rites, leurs affinités, leurs règles, leurs coups de gueule. C* m’avait raccompagné au dehors, avait fermé la porte de l’atelier, non sans m’avoir pris en photo devant, pour conjurer la suffisance d’un article écrit sur le Houloc sans y avoir mis les pieds, quelques mois plus tôt. C’était le début de l’été. Les nuits étaient longues.
Le Houloc est une association loi 1901 et un atelier partagé à Aubervilliers. Il se compose de dix-huit artistes : Ulysse Bordarias, Marta Budkiewicz, Camille Le Chatelier, Timothée Dufresne, Mathilde Geldhof, Flavie L.T, Mikaël Monchicourt, Mathieu Roquigny, Raphaël Tiberghien, Mélissa Boucher, Jean Claracq, Célia Coëtte, Hugo Ferretto, Vincent Lhuillier, Audrey Matt Aubert, Lenny Rébéré, Lise Stoufflet, Romain Vicari. Entre chaque atelier des pans de bâche transparente. De la mutualisation aussi, et des recherches communes. Des pratiques qui se croisent, se nourrissent et s’ouvrent au travers à intervalles irréguliers.
Fin d’après-midi, octobre. Le ciel est bas au Pré-Saint-Gervais. Je pianote depuis une bonne demie-heure pour feindre d’envoyer des mails. Je scrolle sur l’interface bleue de mon Facebook, je m’ennuie, vise 17 heures, l’heure diplomate pour quitter un bureau un vendredi. A* m’a écrit : que je fasse un détour par Max Dormoy avant de filer à Auber. Je le rejoins, nous prenons quelques bières et d’autres choses. Une heure est passée et avec elle la semaine. Il prendra le bus. Je le précède dans l’heure bleue, les pommettes rosies au froid de la vitesse, tente de trouver mon chemin de mémoire, à rebours de cette visite titubante avec C*, quelques mois plus tôt. Je me perds. Ruelles étranges. Casse automobile, semblant de lotissement, sièges de PME, pavillons charmants. Je retrouve la rue, ne la reconnais pas. J’ai chaud, je sue, le bus d’A* a pris du retard. Je suis en avance. C’est le cas de D* aussi. Il a l’air aussi perdu, aussi en avance que moi. Nous échangeons. Banalités d’abord et puis conversation. Il me demande des précisions sur la programmation du soir. Je n’en sais rien. Je n’ai que le titre : Raccords. A* arrive en même temps que L*, depuis les différentes extrémités de la rue. L* nous salue, sans nous connaître ; à nous quatre nous sonnons. Lenny nous accueille. Nous pouvons attendre dans le jardin. Ils ne sont pas prêts. Problème de système son. On s’assied, nous quatre qui nous connaissons mal, fumons dans l’effervescence des autres du Houloc, dans l’odeur de soudures en train de se faire. V*, M*, B* nous ont rejoints. L* retrouve ses complices, D* reste avec nous. Plus que deux heures avant le couvre-feu.
HBT est musicien, compositeur, passé par le jazz, le classique et l’électro bien que peu à l’aise dans l’ethos du DJ. Depuis quelques années, et depuis une résidence au Générateur, il expérimente des formes d’écriture collective pour nourrir sa pratique de celles des autres (et vice versa) et inventer «des zones de flou » pour coopérer. Fasciné par les formes que génère la fête, HBT cherche à court-circuiter le théâtral dans la performance, et la polarisation vers le DJ des fêtes techno : rompre l’esthétique du « bâton de parole », dissoudre l’ego, regarder la foule dans une fête et non le musicien sur ses câbles, inventer des « symphonies pour improvisation » et autres formes hybrides, en écho aux formes du cabaret comme du Bauhaus.
Janvier 2020. C* assiste à une performance d’HBT au Générateur. Un mail part de sa boîte. HBT rappelle Célia dans la foulée.On s’accorde. La première (et seule) réunion collective a lieu fin septembre.
Ça se lance. On pénètre dans la salle d’exposition. Au fond, une table à tréteaux, enceintes perchées sur leurs pieds, Macintosh à la pomme rétroéclairée, machines hirsutes de câbles, claviers : arsenal pour live ambiant ou noise ourdi par un augure à lunettes, courbé sur son set up. Avec la bande on s’avance aux pieds des machines, l’on s’assied, l’on ferme les yeux – singeant les postures que l’on pense de circonstance. La salle se polarise vers la musique qui se lance bientôt, nappes et craquements, tempo lent, contemplatif, boucles qui s’installent, round d’observation, kick timide qui disparaissent aussitôt annoncés, le mec pose ses ambiances. Ça dodeline tranquille. Et puis le sample s’étire et déconne, change de tonalité, se met à glitcher. Quand j’ouvre les yeux, une femme accroupie (Camille) s’applique à déposer des encres naturelles de couleur du haut de ses pipettes sur une plaque de plâtre, et la composition instable qui y prend forme est projetée au mur derrière moi. Mon esprit cherche les analogies formelles, la danse des encres au creux des beats, et ce sont de petits instants de grâce lorsque cela fonctionne. J’assiste à un dialogue qui prend forme entre ces deux qui ne se regardent pas, mais semblent s’écouter. Moi je ne sais plus où donner de la tête : le musicien ? Camille ? la projection derrière moi qui me force à me tordre le coup ? Le public s’hybride, se réorganise, la géographie de la salle mute, on s’essaye à de nouveaux points de vue. On ignore d’où viendront les prochaines formes.
Réunion au Houloc. L’idée d’un dialogue dont on ne connaît pas encore trop les contours. Proposer à chaque artiste du Houloc d’interagir avec lui à partir d’une forme (accrochage, performance…), partir des « fonds de tiroir », des idées non réalisées, de projets aux formats impossibles (trop courts, trop longs, trop humbles, trop minces)… En quinze secondes, la boîte de Pandore est ouverte. Ça fuse.
Je crois que j’ai trouvé le trick. Dans la composition sonore qui s’étire, des tessitures différentes viennent convoquer des tableaux et, depuis le public restreint où je me tiens, c’est un corps toujours proche du mien qui s’extirpe du tamisé de la foule, répondant à un signal dont nous n’avons pas, nous, la clé, mais dont nous comprenons – à la vue de ces corps qui trépignent, poings serrés, balance instable et jeu de jambes du boxeur en chauffe, bustes sur le qui-vive – qu’un son de reconnaissance viendra les mettre en mouvement. Mathieu se lève, dans son grand sweat vert, fait le tour de la table à tréteaux, se cale derrière le micro, nous regarde, calme et presque goguenard, patiente, temporise, et claque au micro une belle bulle de malabar, puis une autre, dans les rires naissants, et le clin d’œil du mec aux platines qui enfile en live looping les différentes tonalités des bulles à sa track qui s’accélère. Lui succèdent un poète timide (Raphaël) profèrant des incantations dans une cavité en céramique qu’il caresse et tapote, et un orateur (Mikaël) sous speed tombé en amour des polyptotes proférant des suites de mots essoufflées dans l’inter-monde, alors que le son passe du noise au drone, et que dans les ventres l’on sent poindre, timidement encore, un kick qui progresse et ne semble plus vouloir nous lâcher.
Dans l’intervalle, allers/retours nombreux au Houloc. Dialogue en tête-à-tête derrière les cloisons de bâche. Maïeutique ? HBT écoute, propose des samples, le fait évoluer, recombine instruments et machines, cherche à donner une voix aux formes qu’on lui propose.
Exemple A : Mathieu Roquigny qui encapsule en ce moment des chewing-gum dans des glaçons en résine et dont la fille de six ans ne communique qu’avec des explosions de bulles en cascade, quand elle ne chante pas I want to move it : incipit tout désigné à un dialogue noisy machines B2B bulles en guise d’offrande à la fille de Mathieu.
Exemple B : Célia a moulé les mains de chaque artiste de l’atelier participant à la performance, doublant son geste d’une question sur les styles de danse de toustes dans une nuit techno. Chaque main vient contaminer son corps depuis les récits récoltés, sol fertile pour une mise en son d’HBT.
Parce que le rythme invite à la danse et que j’ai les jambes ankylosées, je me suis levé puis accroupi, et j’alterne les positions, ne tenant plus à ma place. C’est le cas d’une bonne partie de l’assemblée : jeu de pistons ensuqués parmi lesquels patientent on ne sait combien de corps prêts à bondir à l’invite des enceintes. Prêtresse au calme froid, elle (Anaïs) fend la foule avec une plaque de verre, s’agenouille et commence à tailler un crayon. Sédiments de pelures anthracites qui composent les visages d’une abstraction ; douce hypnose d’une mine qui se réduit à mesure, sous l’injonction d’un poignet martial et lent. Lorsque le crayon disparaît, c’est dans un angle de la salle que se déclare une vidéo flashy (Lenny) sur un écran diffracté par un miroir voisin, et je vois apparaître le visage de L* avec qui j’ai patienté dans le jardin, mirant la salle, les yeux au bord du gouffre. Je ne me suis pas trompé, le kick nous accompagnait et le voici qu’il rugit tandis que celle qui trépignait le plus se met en mouvement. C’est Célia qui s’agite, ramasse des moulures de mains humaines, celles-ci en prolongement des siennes, comme rendue en transe. On ne sait plus si c’est Célia ou ces mains successives qui guident son corps dans des danses hétérogènes, qu’elle fait taire à mesure en fixant ces mains aux murs, redevenues immobiles, encore magiques.
Jour J : ni répétition ni filage. Un seul appel au sample. HBT fait l’appel et passe en revue les différentes pistes, les performers reconnaissent, acquiescent, se signalent. L’on cherche « la même adrénaline qu’une première fois pour garder intacte l’énergie des formes proposées au public.»
Je n’en peux plus, il faut que j’y aille. J’y vais. Aux chiottes. Trois bières, ça va vite. Je suis ivre sous mon masque, je peine à viser la cuvette. Et je le sens, alors que mon jet ne semble plus vouloir en finir, que les bpm s’accélèrent, s’approchant dangereusement des franges d’un débordement festif, et je m’empresse de finir, remets mon masque, tente de rejoindre le centre de la pièce au milieu des corps à présent tous debouts, et par-dessus la houle de leurs épaules je vois ce gars en jaune (Hugo) flirtant avec un monochrome jaune accroché devant lui, guinchant comme un forcené une simili-parade nuptiale pour faire rougir le cadre, contaminant les corps proches de la furie de ses gestes, jeu incurvé des bras et mains, balancier souple des jambes en cadence. Et puis ça redescend dans les hauts parleurs, l’énergie nous quitte comme elle est arrivée. Ne reste plus que le monochrome, jaune toujours, esseulé par le danseur disparu, et près de l’autel, c’est une voix féminine qui donne corps à des cartes postales que ses doigts égrainent, mots venus d’on ne sait où, images d’Épinal et intimes révélées.
Accident : Événement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts, met en danger.
Hugo réagit à un sample drone à la tessiture sans doute trop proche du sien. Il entre en mouvement. Scorie, accident. La musique accompagne sa danse, et décélère, libère une parenthèse pour Mathilde avant que les danses n’explosent au grand final.
Et puis elle vient, enfin elle vient, furieuse et invoquée, elle vient, dans nos corps rendus tacites et les gestes que l’on lance dans le cube, dans les rondes et demies-lunes, elle vient la danse, comme trop retenue, elle vient dans les cris de joie et en une dépense acharnée, dans les clopes qui fusent dans la nuit et les chevilles qui manquent de se tordre, c’est la contagion d’une énergie qui invente de polarités nouvelles, immergeant les protagonistes du moment dans l’urgence de l’excipit de cette fiction partagée à plusieurs et dont l’on sait déjà tous qu’elle devra prendre fin bientôt. C’est l’automne. Il est 19 heures 30 et il semble que l’on ait avancé la nuit. Les lumières se rallument. Toustes nous partons, nous traversons le jardin. Revenu à la rue, il me semble avoir à nouveau touché, comme en cette nuit de juin, l’énergie de cet atelier et des présences qui le composent. Et je n’ai pas eu besoin du jour.
—————————————————
Le présent texte combine les impressions premières de la performance Raccords un soir d’automne au Houloc, les tentatives de recomposition d’une mémoire lacunaire et inclinée au fantasme, les récits récoltés auprès de Célia Coëtte et Julien Haguenauer, et les ambiances tirées d’une fiction en cours. Il est une tentative de suture impressionniste, tout en ayant renoncé d’emblée à dire la contagion magique qui a habité le corps de son auteur quelques heures, un vendredi soir, avant que la nuit ne se couvre.








Photographies : Adrien Thibault.