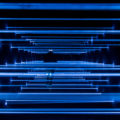MASSACRE AU MUSÉE DE LA CHASSE
Entrer dans l’exposition relève du rite. Nous enfilons des couvre-chaussures blancs et revêtons de fait un costume, l’acteur entre en scène. Il faut se baisser, courber l’échine pour passer la porte, basse comme celles de ces lieux sacrés dans lesquels on pénètre en faisant une révérence. Nous entrons, donc. Le sol est recouvert d’une moquette grise qui remonte sur les murs et une lumière résolument factice baigne cet intérieur irréel, éclat macabre des néons, surexposition. Des socles parsèment l’espace, deux étagères courent sur les murs. S’y pressent quantité d’objets aux formes hybrides et artificielles, alignés là, formant de grandes phrases musicales aux mille sonorités, en rythme, là, des recompositions de la nature, des objets parfois précieux parfois vulgaires, des qui font vrais et des qui font faux. Doute. Sculptures créées in extenso ou compositions mixtes, objets issus de contextes multiples, résultats de la collecte frénétique d’un artiste chineur. Nous sommes dans un cabinet de curiosités, avec son lot d’étrangeté et de fantaisie, de découvertes et d’interrogations. L’ambiance qui y règne est de l’ordre de l’expérimental, du laboratoire vétérinaire, parfois même du piège à souris. La domestication du monde et l’anthropomorphisation constante de notre environnement frappe alors le visiteur devenu cobaye d’une expérience transformative. Le spectateur-consommateur, à mesure qu’il déambule dans l’espace, devient l’animal à qui ces objets pour chiens ou chats sont à présent destinés. Entre illusion et réalité, il découvre l’improbable né d’un monde où chaque objet aurait été anthropomorphisé. Domestication outrancière.
Alors que se généralise la prise de conscience des dégâts de l’humanité sur la nature, que perdure l’impact néfaste de l’anthropocène et que chacun se demande comment s’arrêtera cette machine infernale (le pourra-t-elle ?), Théo Mercier questionne la domestication au cœur du Musée de la Chasse et de la Nature. Explosif, le dialogue promet. Sage, l’exposition déçoit.
Voilà plus ou moins l’endroit où je me suis arrêté quand j’ai commencé à écrire ce texte, il y a plus d’un mois. Beaucoup déplorent la rareté des écrits négatifs produits par la critique d’art contemporaine. Malgré la totale liberté d’écriture que nous revendiquons au sein de Jeunes Critiques d’Art, nous n’échappons pas à ce constat global. Alors pourquoi ? Écrire demande du temps, de l’énergie, un engagement personnel qu’il est difficile de donner à quelque chose qui ne provoque ni intérêt ni amour. C’est comme s’obliger à prendre un verre avec quelqu’un que l’on n’apprécie pas, globalement on passe une mauvaise soirée. Alors pourquoi perdre son temps ? Pourquoi écrire sur quelque chose qui ne me plaît pas alors que tant d’artistes m’interrogent ? Pourquoi écrire sur ce projet alors que d’autres propositions de Théo Mercier suscitent en moi bien plus d’intérêt ? J’ai arrêté d’écrire, je m’y remets parce que j’en ressens le besoin. Ce texte ne m’a pas quitté, il doit bien y avoir quelque chose à dire.
Je ne vais pas écrire sur l’exposition, expliquer les raisons qui font que la salle du bas échoue à provoquer chez le visiteur les réactions que l’artiste voudrait transmettre et que le texte d’introduction évoque. Je ne vais pas questionner les choix d’accrochage qui, s’ils permettent une bonne couverture sur Instagram, peinent à conduire le regard vers une quelconque profondeur. Je ne vais pas nuancer ce constat en parlant des salles du haut où le dialogue entre Théo Mercier et les collections rend l’exposition plus convaincante, bien que globalement vaine. Je ne vais pas écrire sur l’exposition mais je comprends désormais pourquoi ce texte ne voulait pas me lâcher : il y a une proposition dont j’ai envie de parler, magnifique.

Massacre, 2019. Dans une grande vitrine de verre sont entassés des masques africains. Ils ont été jetés là, pêle-mêle, comme des ordures abandonnées à la décharge, multitude de corps sans nom balancés au charnier. Ces visages sans vie s’amoncellent et se perdent dans un tout informe. On essaye de distinguer leurs traits, on y arrive parfois. Ces masques sont factices, produits par et pour le marché européen, objets décoratifs pour blancs aventureux. On les regarde et on ne peut s’empêcher de penser aux pillages, aux massacres, aux dominations qui ont rythmé la vie de ce continent. Ces masques – les authentiques – étaient dotés d’un esprit, ils vivaient, créaient des liens entre les mondes. Arrachés à leur contexte et déplacés en Europe, ils mourraient. Ici, ils ont tout perdu, si bien qu’ils sont parfaitement faux, simulacres pour amateurs d’exotisme, ils témoignent de leur douleur. Every Stone Should Cry – c’est le titre de l’exposition – et sur la pommette boisée de ces visages perdus coulerait presque une larme.
Sors de ton marasme
Relève ton visage
Là, autour de toi
Regarde
Les masques gisent au beau milieu de la salle des trophées. Comme eux, nous voilà encerclés par une multitude d’animaux inertes, morts. Empaillés pour leur éclat perdu, ils sont exposés là. Maintiens illusoires d’une beauté déjà disparue, paroxysme de notre penchant à vouloir tout thésauriser, les voilà accrochés au mur. Massacre. C’est aussi le nom que l’on donne à ces têtes d’animaux naturalisées. Les dominations se répondent. On en garde trace, on en est fier. On les montre à nos amis ces trophées, qu’ils viennent d’un village congolais ou de la forêt compiégnoise, on les exhibe. Ce sont de bons souvenirs tout de même, peut-être même de chouettes aventures. Quelle angoisse.
Autour de nous plus rien n’est vivant que la mort.