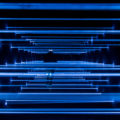Critique sans titre adressée à Thu Van Tran
Chère Thu Van Tran,
La boucle démarre et la spirale du texte commence. Un deux un deux, un…
J’Imagine que toute critique est toujours adressée, que toute critique est toujours critique adressée (dans un autre texte, je parlais de critique relative [1]). Celle-ci t’est donc adressée, en même temps qu’elle se destine à tou.te.s. J’imagine que mon désir n’est pas de dévoiler mais, bien au contraire, de massifier l’objet d’art avec l’artiste et les autres lecteurs. Comment, dès lors, faire bourdonner des voix (et non pas « la » seule, l’unique, la mienne) ? Comment relater (dans ma postposition, étant donné que je viens “après” ton exposition et la production des œuvres) ton exposition Trail Dust à la galerie Almine Rech avec le maximum de sincérité et de sympathie ? Ce texte sera sans titre car aucune thématique ne le sous-tend, si ce n’est cette volonté de créer un lieu-en-commun (partant de ton exposition) à partir duquel nous pourrons échanger et discuter.
Un titre, celui de ton exposition : Trail Dust (traînée de poussière). Celui aussi d’une opération militaire états-unienne durant la guerre du Vietnam – guerre chimique livrée de 1961 à 1971 – visant non seulement à contaminer les terres « ennemies » mais surtout à détruire, dépeupler le vivant. Ce titre de Trail Dust est là et ouvre ton exposition vers ces vastes écocides actuels, toujours, qui se forment en génocides (nulle coupure entre la terre et ceux qui habitent). Il y a les mémoires non seulement du Viêt Nam en guerre, mais aussi de ces vastes zones transformées par les impérialismes en vastes plantations / monocultures : comme les plantations de caoutchouc (ou Cao Su en vietnamien, la traduction est elle aussi histoire de violences car ce mot, la langue elle-même n’a-t-elle pas été « romanisée », européanisée ? Et pourtant, ici aussi s’est joué un phénomène de mélanges imprévues.) en Viêt Nam colonisé. Dans la première salle – blanche – de l’exposition, juste après l’entrée, je vois plusieurs sculptures posées au sol et je reconnais des feuilles de bananier, qui ont l’air desséchées, j’apprends qu’elles sont en bronze. Je lis dans le communiqué de presse qu’elles forment une série, Novel Without a Title, dont le titre est inspiré de Roman sans titre de l’écrivaine Duong Thu Huong [2].

( J’imagine au milieu du texte une critique dans la critique : celle du livre de Duong Thu Huong, Roman sans titre, texte qui esquisse : l’errance d’un soldat vietnamien pendant la guerre, les phénomènes de déshumanisation générale en situation de guerre, où des mains d’orangs-outans se fondent et confondent avec des mains d’enfants; où corps deviennent squelettes; où âmes cherchent rites; où le bô dôi (soldat) Biên se fait fou – fuyant la guerre et redoutant la honte de cette fuite –; où la mort arrive n’importe où : « Un bruit d’avion. Je m’en moquais. Je pensais : « À quoi bon s’enfuir ? Ce sont les balles qui évitent l’homme. Personne ne peut éviter une balle. [3]». Et je me souviens que le héros, Quân, s’allonge et s’évanouit un moment au pied d’un bananier. Ah ! Le bananier de l’exposition…)
L’image des bananiers reste dans ma tête, devient de plus en plus pressante, s’en va avant de se délier dans l’écriture. La boucle reprend. Le texte est jazzé.
Ces mêmes bananiers ou bananeraies qui rappellent les monocultures esclavagistes, les paysages intoxiqués et les mémoires d’errements, les bombardements où les fastes verts deviennent, suite à l’intoxication et aux radiations, oranges comme dans ta photographie en 2013 Du vert à l’orange. Ces paysages jetés à la mer avec ses zhabitants qui rouillent comme feuilles de bananier que tu étales au sol avec leur courbure délicate. Ces feuilles sont figées dans le temps et dans l’espace et constituent une mémoire : celle des exactions coloniales. Elles m’ont parlé, m’ont emmenées outre-mer, là où brûle le chlordécone infectant sous-sols-corps-terres-eaux-rivières. Et même si l’exemple que je viens de citer s’adresse à la situation guadeloupéenne et martiniquaise (où le désastre du pesticide chlordécone, longtemps autorisé par les autorités françaises – Jacques Chirac, alors ministre de l’agriculture – dès 1972, est un des plus grands scandales écologiques, produisant cancers et condamnant toute une population), ceci n’a pas d’importance ici car les écocides et les désastres ne procèdent pas en coupures et en frontières. C’est ce que tu montrais déjà en 2013, lorsque tu t’intéresses à l’irruption du Mont Pelée en Martinique en 1802 et à cette mémoire-martiniquaise qui devient par ton geste, une mémoire-de-toutes-et-de-tous.

Plus-plus (bug) loin dans l’espace d’exposition, il y a aussi cette série de dessins que tu nommes Rainbow Herbicides et qui nous ramène à cette contamination et destruction des terres et forêts vietnamiennes par une série d’herbicides que l’on nomme communément : Agent Vert / Agent Blanc / Agent Pourpre / Agent Rose / Agent Bleu / Agent Orange. Sur tes dessins au graphite, qui donnent à voir un nuage de fumée (celui de l’éruption du Mont Pelée ?), tu traces en haut de la toile et à la bombe aérosol six taches maladroites et figées : l’une verte, l’autre blanche, orange…Mais la dégoulinade de ces « pressions au spray » rappelle le mouvement de ces taches et leur infiltration dans la terre, le sol du papier. Infiltration qui pourtant n’apparaît pas, qui est incalculable et qui ne peut être qu’imaginée. Et j’imagine (douloureusement) le Tétrachlorodibenzo-para-dioxin se dispersant, invisible, et infiltrant atomes et molécules, pour faire monde même système plantationnaire, excluant du domaine du vivant toute la terre, ce qu’il y a sur, dans et sous elle, jetant le monde par-dessus le monde, transplantant la terre hors-terre.

Et j’aimerais te parler de ces dernières pièces constituants la série Penetrable – Rainforest. Où tu joues encore de ces pénétrations – ces « traînées de poussières » –, infiltrations invisibles ou presque-invisibles. Tableaux faits d’aplats de caoutchouc et de pigments, où je reconnais dans ces formes chromatiques peintes sur le tableau, des feuilles d’hévéas qui sont encore ici des traces, taches ; où je relis cette même histoire de plantations d’hévéas au Vietnam à partir desquelles la société Michelin se fournissait en caoutchouc pour la confection de pneus [4], mais où je peux aussi voir des jeux de formes et des rapports entre couleurs; une douceur paradoxale, un travail minutieux et presque obsessionnel des matières.
Le texte retombe, le discours s’arrête de tourner frénétiquement, les boucles se débouclent et-et ouvrent à l’attention, l’intention.
Ne m’en veux pas si cette critique globale n’est pas assez « fidèle » à l’œuvre. Au contraire, je ne voudrais pas que la critique devienne bonne élève mais qu’elle se donne aussi pour objectif de trahir pour aller voir ce qu’il y a, dehors. Je ne veux pas d’une critique d’art aristocratique, demandant bons points. Une critique devrait faire l’école buissonnière et ne plus avoir peur de produire un texte Nègre, c’est-à-dire : scandaleux.
Bien à toi,
C.C
[1] J’avais “croqué” l’idée de critique relative dans : « Ludovic Nino : Écologie des terres et des boues » sur le site YACI International.
[2] Duong Thu Huong, Roman sans titre, Paris, Le Livre de Poche, 2013.
[3] Ibidem, p.40.
[1] Eric Panthou, Les plantations Michelin au Viêt Nam : Une histoire sociale (1925-1940) ; Phu-Riêng : récit d’une révolte, Paris, La Galipote, 2014.